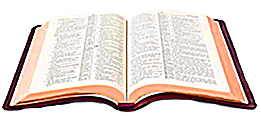- ACCUEIL
- DIOCESE
-
SERVICES GENERAUX
- LA CURIE DIOCESAINE
- BUREAU PASTORAL
- AUTRES SERVICES DIOCESAINS
- BUREAU PASTORAL
- Service diocésain d'Information et Communication
- Comission diocésaine pour le Service du Développement humain Intégral
- Commission diocésaine pour la Culte divin et la Discipline des Sacrements
- Commission Diocésaine pour la Doctrine, l’Œcuménisme et le Dialogue interreligieux
- Commission Diocésaine pour l’Évangélisation et les Missions
- Commission Diocésaine pour la Culture et l’Éducation Catholique
- Commission Diocésaine pour l’Apostolat des Laïcs, la Famille et la Vie
- Commission Diocésaine pour les Vocations sacerdotales, les Séminaires et le Clergé
- AUMONERIES
-
AUTRES SERVICES
- VIE CONSACREE
- VIE DE L'EGLISE
- PUBLICATION
- CONTACT
Origine de la Solennité du Très Saint Sacrement

« Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps… ceci est mon sang, buvez-en tous ».
La célébration de la Fête du Corps et Sang du Christ est due à un miracle qui a eu lieu au XIIIe siècle à Bolsena en 1263. Ce miracle est relaté par les fresques de la Cathédrale d’Orvieto en Italie. Un prêtre de Bohême, Pierre de Prague, avait fait un pèlerinage et avait de grands doutes spirituels notamment sur la présence du Christ dans l’Eucharistie.
Lors d’une messe célébrée par le prêtre, lors de la consécration, l’hostie prit une couleur rosée et des gouttes de sang tombèrent sur le corporal et sur le pavement. Le prêtre interrompit la messe pour porter à la sacristie les saintes espèces. Le Pape Urbain IV vint alors constater ce qui était survenu.
Le pape, ancien confesseur de sainte Julienne de Cornillon institua alors à sa demande la fête du Corpus Domini par la bulle « Transiturus de hoc mundo » le 8/9/1264. Il la fixa au jeudi après l’octave de la Pentecôte et confia la rédaction des textes liturgiques à saint Thomas d’Aquin. La Fête-Dieu ne fut reçue dans toutes les églises latines qu’au temps de Clément V, à l’époque du Concile de Vienne (1311 – 1312) où il renouvela la constitution d’Urbain IV.
Jean XXII, en 1318 ordonna de compléter la fête par une procession solennelle où le très Saint-Sacrement serait porté en triomphe. On fait une procession solennelle le jour de la Fête-Dieu pour sanctifier et bénir, par la présence de Jésus-Christ, les rues et les maisons de nos villes et de nos villages. Les processions du Saint-Sacrement s’inspirent de 1 Rois 8, lorsque Salomon fit transporter l’Arche au Temple.
« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain (…) »
Le pain et le vin proviennent directement des dons de la création, le blé et le raisin, qui sont transformés par l’homme. Dans le pain et le vin il y a une synergie entre l’œuvre de Dieu et l’œuvre de l’homme pour mener la création à sa perfection. Nous sommes collaborateurs de Dieu dans l’œuvre de la création, administrateurs, procréateurs. La synergie entre Dieu et l’homme atteint sa plénitude dans l’Eucharistie. Notre humanité est unie à la divinité du Christ. Dieu et sa création, qui furent séparés par le péché originel, sont de nouveau unis par l’Eucharistie. Notre vie devient alors une synergie avec Dieu, nous réalisons nos actions dans l’union au Christ qui nous habite.
Dieu a voulu habiter au milieu de nous, c’est le mystère de l’Incarnation. Il a ensuite désiré rester avec nous, c’est le mystère de l’Eucharistie. Le Christ aurait pu nous accompagner de mille manières : avec son corps ressuscité, dans un avatar, dans un animal, dans un métal précieux. Mais il s’est fait Eucharistie, aliment, il est venu au plus près de nous. Le lieu par excellence de l’Eucharistie et de Dieu n’est pas le tabernacle mais notre cœur, notre vie quotidienne, la sanctification de notre foyer, de notre travail, de nos amitiés. Nous sommes devenus les vrais temples de l’Esprit.
« Prenez, ceci est mon corps. » « Quod accipimus nos sumus », dit saint Augustin
Le Christ devient un corps donné, un corps offert, un corps rompu. Vivre de l’Eucharistie, c’est aussi vivre dans le don et le service par notre corps, comme Dieu. L’amour qui nous envahit à chaque communion est un amour incarné, un amour fait chair. C’est ce même amour que nous sommes appelés à vivre, un amour qui s’incarne dans nos gestes quotidiens et dans nos circonstances. Le Christ vit donc en nous, et ce pour que notre vie soit en Lui ; très bien, mais quelle est donc cette vie du Christ à laquelle l'Eucharistie nous fait participer ? « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Mais quand on se rappelle pour quelle mission très spéciale le Père a envoyé le Fils parmi les hommes, on est soudain pris d'un doute. Ce n'est pas le confort et le repos que le Christ vient nous apporter, mais la force de devenir nous-mêmes des offrandes. « Quod accipimus nos sumus », dit saint Augustin : nous devenons ce que nous recevons, en particulier en tant que ce que nous mangeons est nourriture. Revêtir le Christ, devenir le Christ, c'est devenir à notre tour la victime de Son sacrifice. Il ne s'agit pas seulement d'imiter le Christ dans notre vie, mais plus radicalement de devenir « une vivante offrande » à la louange de la gloire du Père. « Livre-nous en partage à ceux qui ont faim », demande-t-on aux vêpres du dimanche (IV) : comment, ayant reçu le don total de Celui qui avait souverainement le droit de tout garder pour Lui-même, aurions-nous le droit de garder quoi que ce soit de nous pour nous-mêmes ? Le communiant, en participant au sacrifice du Christ, devient lui-même victime en Lui, et par Sa grâce s'offre à son tour. Nous ne recevons rien que nous ne devions donner. Le témoignage qui nous est demandé ne consiste pas en sermons bien sentis à nos contemporains ni même en une vie édifiante, mais bien à la mise à disposition de notre personne entière au service du salut du monde. Le peuple de Dieu uni au Christ devient sacrement pour l'humanité, lumière du monde et sel de la terre, rappelle Ecclesia de Eucharistia (22). Le corps du Christ offert au Père dans le sacrifice de la messe est indissociable du corps mystique du Christ qui est l'Église. Bossuet renchérit : « l'Église fait elle-même une partie de son sacrifice ; de sorte que ce sacrifice n'aura jamais sa perfection tout entière, qu'il ne soit offert par des saints », rejoignant saint Grégoire le Grand : « Alors vraiment l'hostie sera offerte à Dieu pour nous, lorsque nous nous serons faits nous-même hostie. »

Les meilleurs commentaires
Laissez votre commentaire
Votre email ne sara pas publié. Les champs requis sont marqués par *
Articles récents
- Célébration de la 57ème Journée Mondiale des Communications Sociales
- Paruwase Ryakabamba yarahimbaje mu kanyamuneza n'ubukengurutsi Yubile y'imyaka 25
- Pont entre la foi et la culture, la communication est appelée à être au service d’une évangélisation qui nourrit la confiance, l’espérance et la paix.
- Clôture du Jubilé de 50 ans de l'Enfance Missionnaire au Burundi
- Iyugururwa ry'Umwaka w'Ubutumwa 2024-2025 muri Diyoseze ya Ngozi.